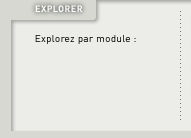|
Symboles / Créations humaines /Visage, masque, icône
| Visage, masque, icône | |||||
Image mère : | |||||
Statues de l’entrée du temple de Ramsès Les portraits ponctuels liés au culte des ancêtres, voire des défunts, n’existent guère pour eux-mêmes dans l’antiquité. Les traits de la personne ne sont pas représentés pour eux-mêmes, mais son souvenir se confond avec son métier ou son attitude familière. Les musées nous montrent ces bas reliefs funéraires ou ces statues votives qui restituent une situation souvent émouvante. Ces œuvres restituent une mémoire et ne constituent pas une présence. Le visage représenté seul n’a pris une importance considérable que lorsqu’il s’agit d’un chef politique ou militaire, les monnaies les plus anciennes, les boucliers romains portent le seul visage du roi, de l’empereur ou de général pour lui attribuer l’activité commerciale ou guerrière. La volonté d’étendre le pouvoir politique à tout le terrain conquis, même si le détenteur du pouvoir n’est pas sur place, s’est traduite en Egypte comme à Rome par la multiplication des statues auxquelles les sujets devaient rendre hommage. L’efficacité de la représentation du visage et du regard du chef, représentant de l’autorité divine, était si importante qu’on tenait à en faire le signe de la présence du Pharaon ou de l’empereur. C’était moins la ressemblance physique que l’emblème universelle qui était en cause. L’histoire sainte cite en exemple la fidélité des trois hébreux condamnés par Nabuchodonosor et les sept fils des Maccabées qui refusent l’adoration du chef du gouvernement comme une idolâtrie. | |||||
haut de la page | |||||
| | |||||